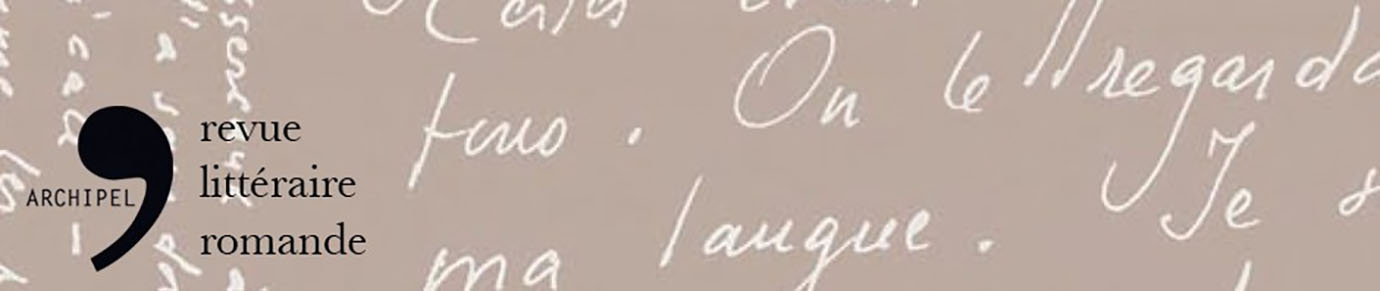L’ado, les sens

Salomé Kiner, Grande couronne, Paris, Christian Bourgois, 2021.
Entre roman d’apprentissage et chronique sociale, Grande couronne tire le portrait contrasté d’une adolescente coincée dans une ville de banlieue pavillonnaire française à la fin des années 1990 et dont les rêves, éclairés par les rayons des supermarchés et les spots publicitaires, défilent comme sur un tapis roulant avant d’aller se briser contre l’implacabilité du réel : « Dans les pubs McCain, on montrait des foyers unis dans leurs salons Far West, des cheminées prospères, un chef de famille charcutant une grosse dinde et dehors une hache plantée en plein cœur d’un billot. Ce genre de vie. Moi, j’avais les soixante kilos de Renaud, sa passion aveugle pour ses abrutis de molosses, la convalescence de ma mère et l’indifférence de mon père. Aucune suggestion ne m’avait préparée à ça » (274). Sous l’impulsion du conformisme – « Mon problème c’était les autres. Ça a toujours été les autres » (10) – la narratrice en arrive à monnayer ses premières expériences sexuelles dans le dessein d’acquérir les multiples produits de marque qu’elle convoite mais que ses parents, auxquels « [c]es histoires de logo ne […] faisaient ni chaud ni froid » (166), lui refusent. À l’instar de Mathilde Loisel dans « La parure » de Maupassant, elle subit le joug de l’apparence à tel point que l’emballage oriente le choix d’un paquet de blancs de dinde, la tenue celui d’une profession future. Débordant le cadre d’une vie modeste, les ambitions de Tennessy – son nom de travail choisi en fonction de la chanson éponyme de Johnny Hallyday – obéissent au culte de la superficialité caractérisé par une offre pléthorique d’objets qui, à l’image du papier toilette à la pêche, n’ont d’autre utilité que de signifier l’aisance matérielle de leurs consommateurs, des « riches qui achètent de la merde » (193).
Bien que l’intégration d’un réseau de prostitution de mineures, motivée par le consumérisme triomphant à l’aube du nouveau millénaire, constitue l’élément transgressif de l’intrigue, celle-ci ne s’y borne pas mais s’en sert plutôt comme d’un tremplin pour toucher à des problématiques plus universelles, telles que la famille, l’amitié ou l’amour. De façon à restituer l’adolescence d’une génération dans toute sa complexité, la primo-romancière Salomé Kiner élabore un univers de l’entre-deux, à la charnière des époques, des espaces et des existences, où l’innocence enfantine se débat avec les désillusions de l’âge adulte, où les chimères de la capitale foulent la platitude d’un quotidien en périphérie, où la douleur et la douceur s’unissent au sein d’une langue truculente et poétique. Sans jamais tomber dans l’exercice de style, elle parvient à traduire la pensée adolescente sous la forme d’un flot de paroles qui, charriant humour et mélancolie, évoque la brutalité du jeune Momo dans La Vie devant soi d’Émile Ajar – une référence revendiquée.
Si le titre de Grande couronne fait directement écho à une région géographique dont l’autrice, aujourd’hui établie en Suisse romande, est elle-même originaire, il renvoie peut-être aussi à la situation personnelle de la protagoniste portant, afin de faire front à un père démissionnaire et à une mère dépressive, des responsabilités trop lourdes pour elle : « […] les garçons ne mangent plus que des raviolis, et encore, quand je les prépare, […] Rachel a changé de famille parce que la sienne lui faisait honte, […] je fais les lessives, le lave-vaisselle, les courses et les inscriptions de rentrée […] » (97). L’aveuglement initialement provoqué par « la religion cathodique » (10) se transforme peu à peu en lucidité, car le principal enseignement retiré du groupe Magritte – nommé ainsi en raison de ses pratiques limitées, contrairement au groupe Courbet, à la fellation et à la masturbation – porte précisément sur la trahison des images, intitulé peu connu du très célèbre tableau « Ceci n’est pas une pipe ». Le livre, sans victimisation ni condamnation, réussit à rendre compte des oppositions qui pétrissent son héroïne, comme une initiation à la sexualité mêlée de haut-le-cœur et de coups de cœur, ou une cellule familiale conçue à la fois comme un principe d’enfermement et de vitalité. D’emblée installée par une ouverture in medias res, l’atmosphère obscure se trouve de bout en bout traversée de petites lueurs volontiers symbolisées par la canine brillante de Chanelle, simple collègue puis meilleure amie avec qui se noue une relation de sororité. Derrière « l’histoire des larmes versées sur l’abandon des hommes » (285) se trame une solidarité féminine illustrée par le tableau final, qui esquisse la possibilité d’une consolation dans le rétablissement du lien mère-fille et, par-là, suggère qu’entre faille et famille, il y a aime : « Peut-être qu’enfin je pouvais comprendre, peut-être que le malheur fédère plus que la joie. Un silence traversa la pièce, il était baigné de tendresse. Ma mère redressait sa couronne quand une volée d’eau tiède nous a éclaboussées. On a sursauté en même temps : Simon s’était cogné le crâne contre le robinet. On s’est précipitées pour lui venir en aide, mais il a relevé la tête en éclatant de rire, et nous aussi » (287).
Sarah Juilland