Du sable sous les dents
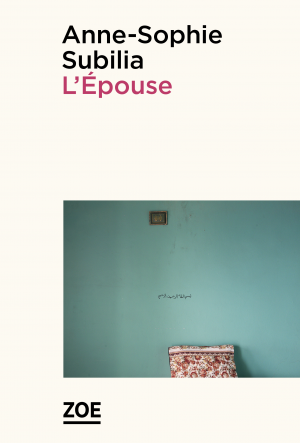
Anne-Sophie Subilia, L’Épouse, Genève, Zoé, 2022.
Le titre évoque l’œuvre, précisément : ce n’est pas le récit d’une simple épouse, de l’idée générale que l’on se fait d’une épouse ; car le texte alors aurait dû s’intituler Une épouse ou, encore plus simplement, Épouse. Mais ce n’est pas non plus une femme très particulière qui est au cœur de ces pages ; car nous aurions alors lu, en première de couverture, Piper Johns. Non, la protagoniste du plus récent roman d’Anne-Sophie Subilia n’est ni un personnage purement générique ou universel ni une femme singulière ; plutôt, elle est dépossédée d’elle-même et renvoyée au statut à la fois unique et partagé « d’épouse de… ». Son prénom n’est utilisé qu’à une dizaine de reprises dans toute l’œuvre, la plupart du temps lorsqu’il est question de son frère, qui gravite dans sa sphère privée. La femme publique n’est pas Piper. Combien de femmes, dans la période où se déroule la diégèse, soit les années septante (et même aujourd’hui), n’étaient-elles pas seulement la femme de leur mari, vivant par et pour lui ? C’est donc un vibrant portrait d’une condition féminine passée et actuelle que nous livre Subilia dans ce roman.
Mais réfléchir à cet enjeu ne suffisait pas à l’autrice, qui fait en plus l’ambitieux pari de nous transporter, avec ce couple suisse au début de la trentaine, à Gaza, où le mari est envoyé pour une mission humanitaire. Vivian est souvent absent, au bureau, en courtes visites dans les prisons des environs ; l’épouse est à la maison, elle l’attend, mais elle n’est pas seule. Elle habite avec le sable, les cafards, les dromadaires du voisin dont on ne voit que les toupets, parfois, et le chien Gayouf, qui semble apporter surtout du bonheur à Vivian. Le lecteur s’adapte avec elle à cet environnement, cette maison qui se meuble progressivement suivant les visites au marché, ce jardin aride qui devient peu à peu luxuriant, par les bons soins d’un vieil homme engagé pour faire pousser des fleurs dans cette cour de poussière. Avec elle, aussi, nous faisons des rencontres, et vivons le malaise qu’éprouve la Blanche en pays militarisé. Piper oscille sans cesse entre la dangereuse figure du white savior, celle du portefeuille ambulant, celle de la femme « libérée » et étrangère qui va à l’encontre des mœurs locales, et celle de la femme lâche et oisive :
Des femmes s’affairent sous ses yeux à l’entrée des immeubles. […]. Elle se décide à s’asseoir quelques minutes à un café, parmi les hommes […]. La femme du délégué voudrait se rendre chez ces femmes, se fortifier, se cultiver. […] Certes, elle aurait un grand désir de connaître des recettes, mais elle prendrait surtout des notes aléatoires dans un grand cahier dont elle ne se servirait pas. (76, 77)
Et elle n’ira évidemment jamais vers ces femmes pour chercher à créer des liens. Mais serait-ce possible de toute façon d’enjamber le fossé qui les sépare ? Pourrait-elle dépasser les nombreuses étiquettes qu’on lui accole, développer des amitiés silencieuses qui sauraient vaincre la barrière de la langue ? Paralysée par ces incertitudes, elle reste passive, sauf auprès de son mari, à qui elle demande parfois avec insistance d’agir pour contrer des injustices qu’elle côtoie alors que lui est au bureau. Elle se fait offrir plusieurs fois de travailler à l’hôpital, dans un monde majoritairement féminin qu’elle admire ; mais c’est impossible, car alors elle jouerait un nouveau rôle, celui d’infirmière, d’employée. Prise de pitié pour une orpheline à l’étage de la pédiatrie, elle la nomme, en prend soin, mais jamais ne l’adopte, car alors elle deviendrait mère. Piper ne peut faire autre chose qu’être l’épouse de Vivian. Elle nage dans la mer, va au marché, lit des livres, fait des tours en voiture, aide parfois Hadj le jardinier, écrit des lettres à sa famille et ses amis, mais jamais elle ne deviendra femme d’action, femme passionnée, femme brûlante. Le personnage n’est pas plat pour autant : par un jeu narratif de focalisations, tour à tour externes puis internes, la complexité intérieure de Piper se dévoile progressivement, et ses tourments deviennent rapidement les nôtres, résonnant étrangement avec l’actualité.
Le fait de poser l’action dans un lieu et des temps relativement éloignés offre finalement la possibilité d’un pas de recul sécuritaire pour aborder des questions toujours présentes. Évidemment, sur le conflit qui continue de régner à Gaza et dans les environs, mais aussi sur le pouvoir de la personne privilégiée en terrain étranger. Comment venir en aide aux gens défavorisés sans verser dans un néo-colonialisme toxique ou dans la figure du sauveur adulé ? Comment penser les différences entre les cultures européennes et arabes sans glisser dans le relativisme culturel ? Anne-Sophie Subilia offre de belles réflexions autour de ces questions délicates, que l’on peut facilement partager au vu de l’hybridité du personnage de Piper, à la fois générique et personnel, permettant l’identification critique du lecteur. Nous entrons souvent dans les méandres de sa pensée par la focalisation interne ou le discours indirect libre, mais la narration est aussi par moments quasi cinématographique ; le regard que nous posons devient alors plus libre et distant. L’apparition du « on », sans être abusive, est assez fréquente dans l’œuvre, et donne le sentiment du point de vue de l’œil derrière une caméra :
elle se retourne et voit Vivian encore empêtré. Il palpe sa poitrine, prêt à ouvrir les boutons-pression et sortir quelque monnaie. Elle revient sur ses pas, le tire par la main en disant khallas ! Ça suffit, yalla ! S’adresse-t-elle à lui ou à la troupe insistante ? On ne sait pas. Ils bifurquent dans une ruelle de Gaza. (37-38)
Ce regard impersonnel que produit l’emploi fréquent de ce pronom permet à la narration de se dissocier du personnage, et de le montrer sous un angle plus objectif, offrant habilement un espace de réflexion sans transformer l’œuvre en roman militant ou activiste.
La littérature contemporaine se méfie beaucoup des écritures qui s’approprient la vie des autres ; le long doigt qui pointe et qui crie à l’imposture pèse comme l’épée de Damoclès sur la tête des auteurices qui se lancent dans ce grand exercice d’empathie et de projection. On ne peut qu’admirer l’audace qu’a eue Subilia de poser un regard blanc sur la réalité des Gazaouis d’il y a quarante ans pour faire résonner des enjeux contemporains, judicieusement, et sans jamais omettre de faire crisser le sable sous nos dents tout au long de la lecture, de nous en mettre plein les ongles, les casseroles, le plancher. Le coup de balai est inutile, il faut accepter son omniprésence.
Florence Bordeleau-Gagné
