S’empailler avant les flammes
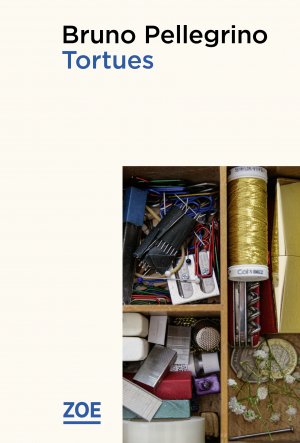
Bruno Pellegrino, Tortues, Chêne-Bourg, Zoé, 2023.
Le plus récent ouvrage de Bruno Pellegrino s’ouvre sur une dizaine de paragraphes étonnants : ils sont meublés d’animaux figés, jadis confiés aux bons soins d’un taxidermiste de musée et désormais à répertorier par l’écrivain, qui déclare : « je me prends d’affection pour le perroquet-hibou, étrange oiseau qui refuse de trancher, menacé d’extinction et classifié comme spécimen rare à sauver en cas d’incendie. » (7) Peu après, il insiste sur la tortue qui s’y trouve aussi, désolé d’apprendre qu’elle ne serait sans doute pas, elle, prioritaire, et qu’elle périrait sous les flammes. Il souligne également que le taxidermiste a empaillé cette pauvre tortue un peu maladroitement, alors qu’elle était déjà en décomposition.
S’ouvre ensuite un texte, d’une quinzaine de pages, sur une écrivaine dont il doit constituer le fonds d’archives, après sa mort.
Si le thème principal est de prime abord évident (à savoir, l’action de classifier, consigner), les images des animaux empaillés, du feu et surtout de la tortue, induites par les phrases liminaires, résistent et flottent, en suspens dans l’esprit du lecteur, qui se laisse captiver sans difficulté par les divers petits textes qui suivent, et qui s’inscrivent tous dans une logique oscillant entre le général et l’indéterminé (les titres en disent long : « l’écrivaine », « l’enfant », « la Turquie », etc.), et le particulier et l’intime (nous sommes malgré tout dans un recueil dans lequel le « je » narratif se confond sans ambiguïté avec l’identité de l’auteur). Le feu reste malgré tout un leitmotiv. Voguant de souvenir en souvenir, Pellegrino jette un regard inquiet sur sa mémoire faillible et mouvante. Depuis tout petit, dit-il, il archive sa vie dans des calepins, et s’assure d’être prêt, si sa maison doit être ravagée par les flammes, à pouvoir se saisir rapidement des essentiels pour les amener avec lui. Ces petits objets, ce sont un peu ses perroquets-hiboux. Et ce petit tiroir dans lequel il les garde, c’est sa carapace de tortue. Pellegrino nous expose son souhait d’être mobile, mais toutes les peluches ne peuvent être conservées. Tous ces films, photos, journaux : il faut faire un tri et accepter que certaines choses périront.
Mais l’écrivain sait que ces choix – garder, jeter – ne sont pas sans conséquence. Son travail d’archivistique lui rappelle sans cesse que plusieurs tombent dans l’oubli, et que les documents les plus banals peuvent servir à reconstruire toute une vie : c’est ce qu’il appelle la « molaire du dinosaure », qui permet à elle seule de reconstituer une bête préhistorique tout entière. C’est ainsi qu’il se plonge dans les factures, lors d’une résidence d’écrivain dans un vieux château, d’une femme d’éditeur allemand qui a habité là. Que reste-t-il de Jane Scatcherd ? En étudiant ses quittances, il apprend qu’en 1994 elle a fait un grand ménage de printemps. « Je me laisse fasciner par ce train de vie de grande bourgeoise », écrit Pellegrino, « Il ne s’agit pas de nostalgie, je n’idéalise rien. C’est seulement qu’en l’absence de marche à suivre, observer des vies passées m’aide à m’orienter dans la mienne. » (83, 84).
Et Jane ressuscite à travers ces hypothèses, ces découvertes fondées sur des riens ; elle lui devient réelle (81).
Ainsi, pour une personne qui rebâtit des vies grâce à ces vieux morceaux de papier anodins, l’on peut imaginer tout le mal à trouver ce qui est important. Comment bien trier ses choses, comment devenir une bonne tortue et sauver l’essentiel des flammes à venir ?
Tombant par hasard sur le seul recueil de poèmes d’une certaine Marthe D., Pellegrino s’imprègne, malgré le style « suranné » des alexandrins (38), à cette œuvre de jeunesse : « le livre refermé, son rythme restait en tête […]. [J]’ai rouvert le livre. Abandonnant toute rigueur analytique, je suis parti du principe que chacun de ses mots était autobiographique. » (39) Et c’est à la fin de l’avant-dernier texte que nous apparaît la boucle qui se ferme, quand l’écrivain fait un grand ménage dans ses affaires accumulées, par « horreur du vide », chez ses parents. Il ne sait trop quoi jeter : « même ma poubelle en osier, il me semblait prématuré de m’en séparer. Il aurait fallu pouvoir tout mettre dans un livre, léger, complet, facile à emporter en cas d’incendie et qui fonctionnerait comme la molaire permettant de reconstituer le dinosaure entier. » (122) Est-ce l’équivalent du livre de Marthe que nous avons entre nos mains à la lecture de Tortues ?
Cette démarche me fait penser, un peu, à celle de Montaigne, cet homme qui craignait l’oubli de son nom, faute de fils pour le transmettre. Seulement, Les Essais ne constituent pas un volume très léger. Ou bien, donc, Montaigne n’avait pas l’esprit minimaliste, ou bien Pellegrino est encore jeune et peut encore prétendre à la mince plaquette que constitue Tortues, qui augmentera au fil du temps. Ce petit livre regorge d’intertextualités, comme celui du philosophe français ; simplement, Astérix et Tintin remplacent Plutarque et Sénèque. Les écrivains et personnages qui marquent nos parcours intellectuels représentent peut-être tous, à leur façon, une boîte de Pandore, le sac de perles d’Hermione, la molaire du dinosaure. En tout cas, c’est l’impression que nous laisse Tortues, nous invitant, indirectement, à nous laisser aller au même exercice rassurant, celui de trier, de trouver l’essentiel, qui est constitué finalement de ces petits bouts de rien qui permettent d’ouvrir nos univers.
Ce qui est remarquable, dans cette œuvre intime, c’est que Pellegrino ne se limite pas à son monde à lui, à son portrait à lui. Il tire de l’oubli des femmes presque anonymes, ayant vécu dans l’ombre. La dernière partie, « Françoise », émeut particulièrement, par la force des mots. Si l’on se demande parfois si les hommes peuvent parler des femmes, nous avons ici un exemple d’exercice sensible et réussi, qui me fait beaucoup penser, avec affection, à la démarche de Serge Bouchard, au Québec (Elles ont fait l’Amérique, Montréal, Lux Éditeur).
En quelques mots, donc, ce court recueil s’inscrit dans un double mouvement : celui de restituer la mémoire de celles et ceux qui n’ont presque rien laissé de tangible, et celui de chercher à ne jamais perdre la sienne, malgré sa faillibilité, ses incertitudes, ses doutes inévitables. Pellegrino propose d’accepter, un peu à contre-coeur, la part de fiction que comporte l’existence humaine : nous ne saurons jamais trop (et Pellegrino sans doute pas plus) si tel ou tel moment de son voyage familial en Angleterre s’est réellement produit, mais cela n’a pas d’importance, car le portrait d’une personne se dessine au-delà des faits véritables.
Florence Bordeleau-Gagné
