L’amour et l’amer
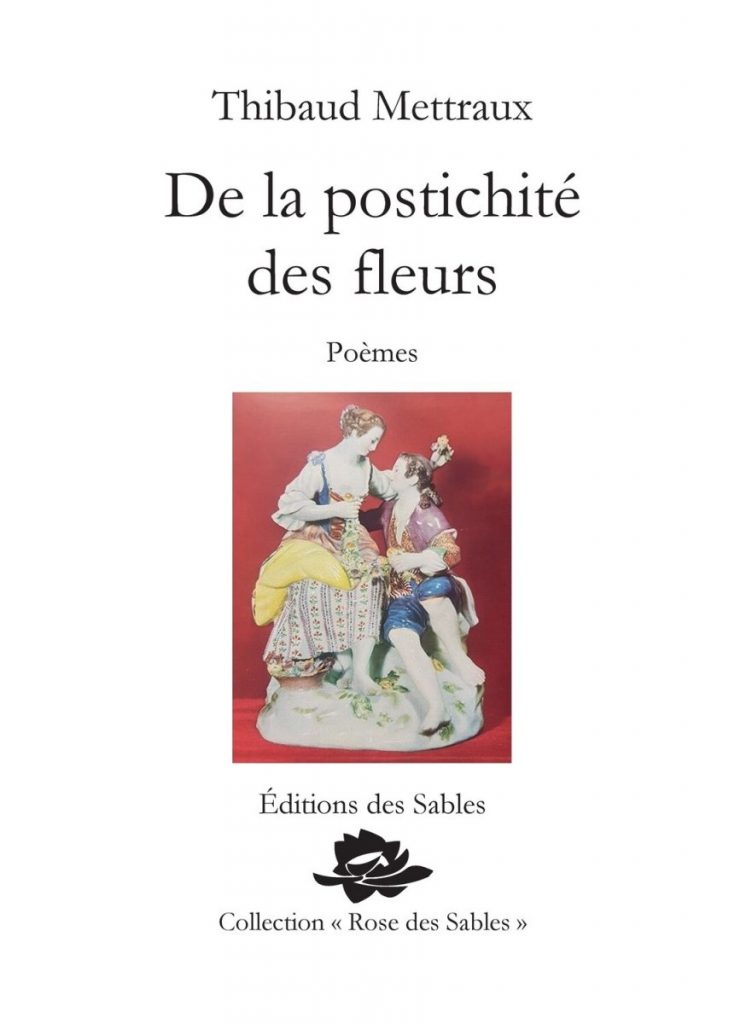
Thibaud Mettraux, De la postichité des fleurs, Perly, Editions des Sables, 2022.
Le pédantisme excentrique du titre connote bien des choses : une rareté sophistiquée, mais d’une sophistication si guindée qu’elle doit être la trouvaille d’un espiègle dandy, résolu à jouer, dès le seuil, avec son lecteur, c’est-à-dire à en faire sa dupe en même temps que le compagnon de sa musette. Mais, dans cet alliage sémantique hétéroclite qu’est le titre, c’est aussi – je crois – une singularité qui s’annonce, un nom qui surgit dans le champ poétique.
Peut-être faut-il préciser d’emblée que le premier recueil de Thibaud Mettraux s’adresse avant tout aux amis de la forme : il faut, pour entrer dans cette œuvre, aimer les audaces de la rime et les libertés du vers tantôt bien fait, tantôt défait, parfois encore plaisamment malmené ; il faut peut-être aussi avoir fréquenté l’histoire de la poésie – et particulièrement ses inflorescences modernes (Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, etc.) – pour appréhender le positionnement poétique qui se dessine au fil des pages ; il faut, enfin, apprécier les cryptages, les suggestions du mi-dire, les amphibologies, ces soustractions de sens ne recouvrant ni ne découvrant au final rien que « le scandale de la trivialité » (7) : la vie, le sexe, l’amour.
Mais si l’on saisit bien des choses, le je lyrique restera, mieux que Protée peut-être, insaisissable. Le sujet lyrique est à la fois enfantin et roublard, cruel et tendre, cauteleux et candide, poissard et précieux. « Comptine » (16-17) exprime bien cet ensemble de dualités ; le poème y devient miroir des ambivalences du sujet qui exhibe ses masques et sa duplicité mélancolique. Mais le caractère équivoque du sujet lyrique est aussi psycho-sexuelle (voir « Lendemains », 37) et renvoie à la bifidité d’une voix qui oscille entre l’énonciation masculine et féminine, mais aussi d’un désir, entre l’homme et la femme, entre le père « qui ne fait pas la sourde oreille » (exergue) et la nausée du mal de mère à la dernière page (61), à la dernière ligne. Insaisissable, l’instance d’énonciation l’est aussi parce que, dès la « Préface » (12-13), elle retire toute justification à l’acte poétique, celui-cii étant réduit au rang de bibelot métaphysique réservé à l’enfance et à ses émerveillements exaspérants. En d’autres termes, la raison du poème n’est jamais qu’un puéril prétexte et se situe, pour cette raison, en-deçà de l’intensité poétique, inégalable. Toute possibilité de transcendance se voit congédiée parce qu’irrévocablement « tiède » (13).
C’est que les fleurs, n’est-ce pas, sont postiches : elles sont faites et ajoutées après coup, artificielles apparences que la virtuosité seule anime ; elles sont feintes aussi, affectées et parfois mensongères ; mais surtout, elles remplacent, comme une fausse barbe, quelque chose qui fait défaut, qui peut-être fit défection. Le poème est une forgerie tracée par le manque, un clin d’œil ironique à l’équivoque, un dégrisement encore gris, encore ivre. Mais si la recherche des intensités demeure, si le sujet lyrique repousse « la vie sans heurts », il reste pourtant, à la chute de « Entre le cloître le verger » (22) comme une faille de dérision : « Seule une fleur qui ne s’inquiète / Vole au vent », le mouvement insoucieux et ascendant rappelant aussi la gastronomie des cantines d’école : présence infime de la régression et du mauvais goût ?
L’ivresse n’est pas seulement lyrique et les alcools ne sont pas juste des poèmes : récits elliptiques de biture, confessions d’un « golden-boy en chevalière » (35) ; confidence et gueule de bois de celui qui n’a « jamais été du lendemain » (23). La progression brisée du vers (en italique) dans « Des crépuscules » signale, par le retour brutal à la prose (en romain), l’horizon pulsionnel autodestructeur des soirées qui s’achèvent, au matin, quand le je finit par « s’écrouler sur le bitume au-devant du magasin qui borde votre allée » (38). C’est que si la sensualité déliée du sexe est fort présente sous forme d’ « Invite » (18) ou d’« Alternative » (49) peu glorieuse, l’amour et le chagrin qui va avec ne sont jamais bien loin.
L’amour apparaît comme le noyau du recueil. Il irradie, plein et chaud comme la plage sur « la baie de Bahia » (46), comme le corps de l’aimée, comme « le bracelet du mois d’août » (46), symbole naïf du lien et du deux qu’il noue dans l’extase. Il donne aussi sa structure chiasmatique au recueil, les répliques échangées par « L’Autre » (14 et 55) et « L’Un » (15 et 56) se situant en ouverture, puis en fermeture de l’oeuvre. Ce chiasme figure le début et la fin d’une relation ; il enferme ou sertit le souvenir si cher, maudit et médite la rupture dont, le plus souvent, il désespère – par exemple dans « Convert » : « Il n’est depuis toi plus / Que d’équilibre idoine / Et moi que l’on connut / Pitre je vis en moine » (57). À bien y réfléchir, la séparation est figurée d’emblée sur le blanc qui séparent les pages : il n’y a pas de « et » entre l’un et l’autre, entre les deux amants. Bientôt, c’est donc l’« Adieu » (60) qui clôt presque le recueil et cicatrise la plaie en achevant « l’état des lieux » (60).
Insaisissable, je l’ai dit : on devine, on subodore, on flaire dans les labyrinthes et les recoins de l’œuvre ouverte, on fleure les parfums dans les allées du jardin clair. On assiste au scandale ordinaire du drame amoureux, on s’égare dans les « déserts / Abreuvés et nomades » (61). Singulier, je l’ai dit : par ces raffinements de fausset ; par la virtuose artificialité de cette musique postiche qui n’atteint rien, sans doute, que l’expression du manque ; par le refus ironique, enfin, opposé à toute patrimonialisation symbolique (« Pastorale, 19-21), à toute immobilisation du vers. L’écriture n’est alors peut-être rien que la dérive enivrante de la forme, ce recueil le témoignage fragmentaire des possibilités infinies qu’elle ouvre.
Vivien Poltier
