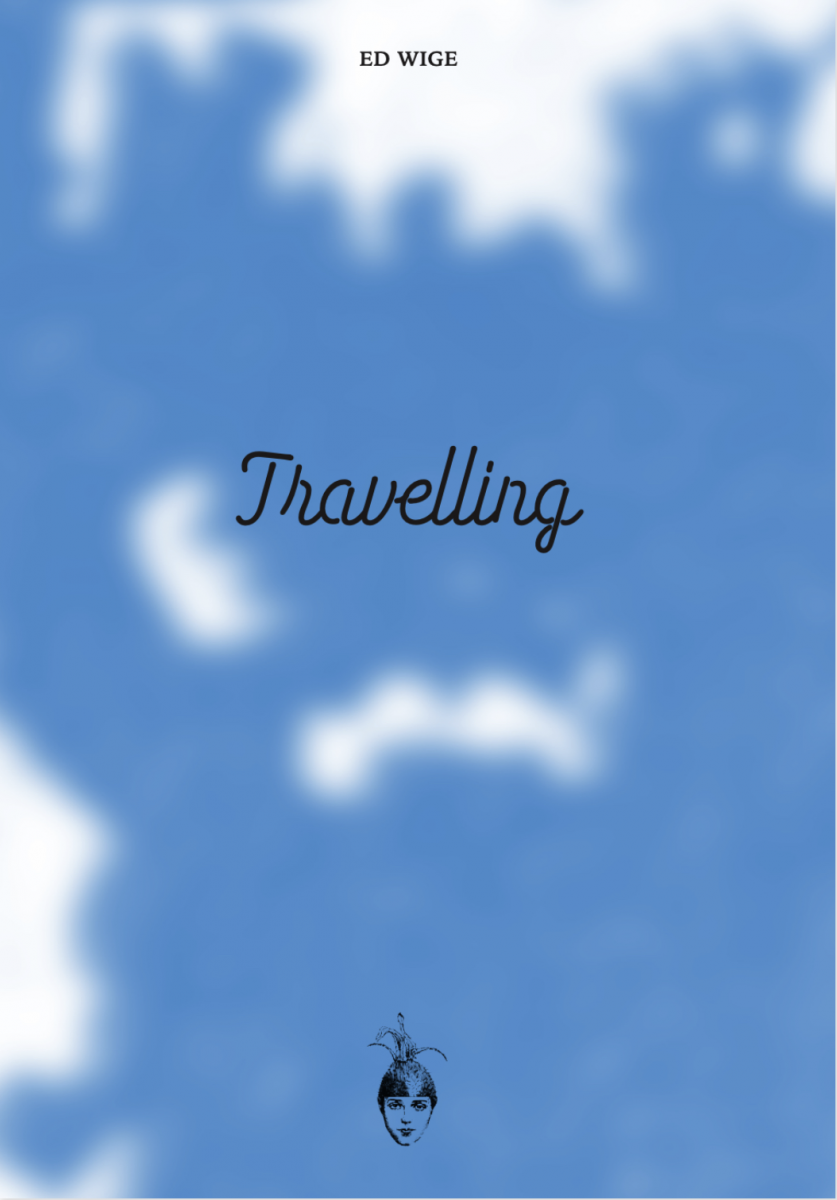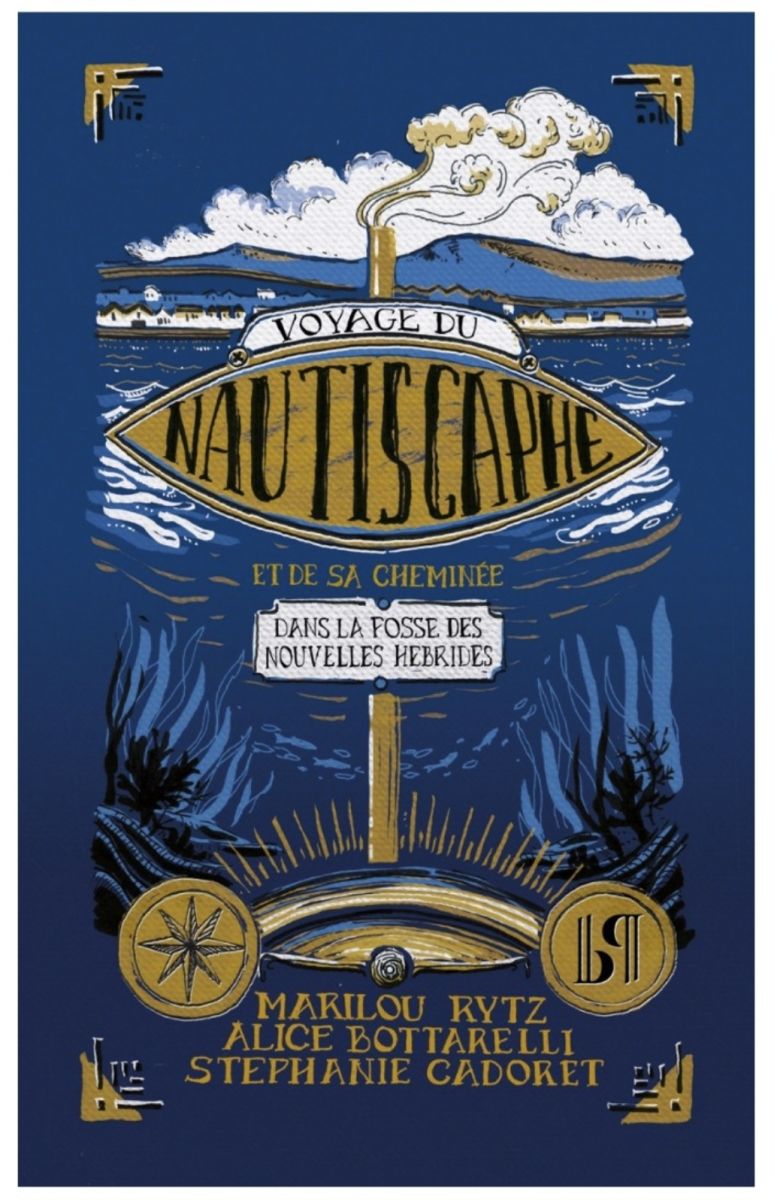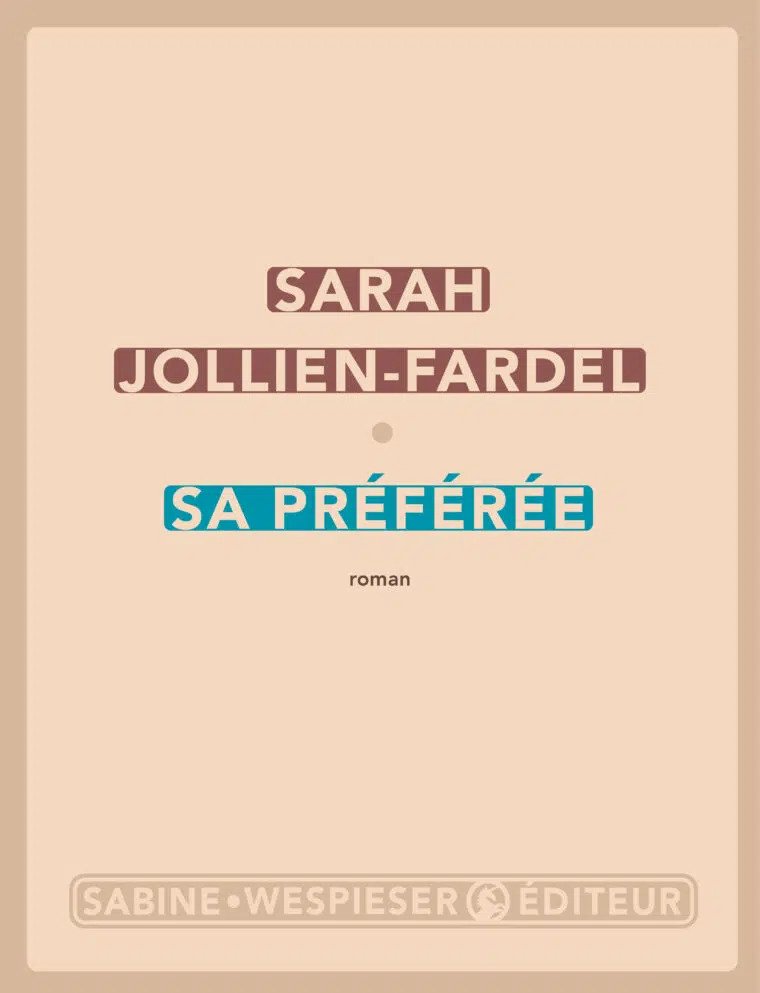Compte rendu d’Ed Wige, Travelling, Lausanne, Paulette éditrice, coll. « Grattaculs », 2025, 201 p.
« Qu’est-ce que je fous là » (89), se demande Deniz, fraîchement arrivé·e à Shanghai pour suivre les tribulations professionnelles d’Andrea, sa·on partenaire. Cette question pourrait être un refrain générationnel, ritournelle d’un monde en déliquescence entre le greenwashing des grandes entreprises et celleux qu’on appelle « expats » uniquement parce qu’iels sont blanc·he·s, qui quittent le pays à la recherche d’un marché du travail plus flexible (en langage de manager, précaire, justement). « Qu’est-ce que je fous là », c’est aussi le constat du métissage de Deniz, « enfant de lait » de parents turcs immigrés en Suisse, coincé entre deux eaux, « trop cajolé par la mère et la Suisse », selon son père (87), en pratique « secrétaire » de ses parents comme tant de jeunes qui connaissent mieux la langue du pays d’accueil que les membres de leurs familles. « Qu’est-ce que je fous là », c’est enfin ce que se demande Deniz dans son couple, à un terrible repas de Noël de boîte à Shanghai, invité·e en tant que conjoint·e mais proprement invisible, miroir de la maison vide, du travail aliénant d’Andrea qui ronge sur le quotidien : « la dinde aux marrons laissera-t-elle une impression plus prégnante que moi, ce soir ? » (92), se demande-t-iel amer·ère. Le deuxième roman d’Ed Wige, après son remarqué Milch Latte Mleko, également publié par Paulette en 2023 et récompensé du prix Suisse de littérature 2024, s’égrène au son de cette question qui prend des couleurs existentielles.
Pourtant, les histoires d’amour qui se défont sur fond de villes asiatiques, rien de neuf apparemment, voir Lost in Translation (Sofia Coppola, 2003). Travelling a bien quelque chose de cinématographique, car il est rythmé de ses différents « exit et stop » (46), pour reprendre une autre ritournelle : mais il ne s’agit pas que de cela. Le récit d’Ed Wige ne se contente pas de se développer thématiquement autour de la précarité, d’abord financière, qui se répercute sur les sentiments, les désirs, mais construit une narration elle-même constamment précaire, fondée sur le principe du travelling, qui (l’épigraphe le rappelle un peu didactiquement) veut dire « voyage en cours », par définition, la forme grammaticale du temps continu appuyant l’inachèvement de l’action (7). Mais le travelling consiste aussi en un déplacement de la caméra au cours de prises de vue, afin de se rapprocher, s’éloigner, s’écarter, se déplacer, bref, donner un autre angle sur l’action en cours. Les multiples « exit et stop » qui rythment l’histoire sont la transposition littéraire de cette juxtaposition de temporalités, où « dans une autre version de l’histoire » (47), les personnages changent d’avis. Échappent, justement, au scénario attendu, donné en anglais pour en exhiber la consistance de chewing-gum prémâché : « Deniz et Andrea lived somehow happily ever after, in Switzerland… avec des disputes régulières et des litres de café. » (46) La caméra refuse obstinément de s’arrêter, comme les désirs, les incompréhensions, les désirs de liberté, et les projets. C’est l’ambition qui fait partir Andrea, habitué·e des relations à distance et de la vie en pointillé des workaholics, « son quotidien s’est rempli à craquer de factsheets, workshops, trainings, capacity building events et, au final, beaucoup de bullshit. Une situation confortable. Ça aurait pu durer. » (11)
Le regretté David Graber consacrait il y a quelques années un ouvrage tragi-comique aux bullshits jobs, parfaitement inutiles, voire nuisibles, par leur peu d’impact réel sur le monde. Pourtant Andrea ne voulait pas ça. C’était plutôt un envie de partir : « Sa maison, c’est le dépaysement, au fond. » (80) Cependant, en réalité, le pendant de la bulshittisation des jobs, c’est la précarisation, dans la pure tradition néocoloniale comme en atteste le personnage de Jenny, « la vieille joyeuse ou la jeune soucieuse » (90), employée de maison chinoise fournie par l’entreprise : « Deniz ne s’occupera de rien. Elle s’occupera de tout. » (90) La complicité entre Jenny et Deniz, solidarité de classe car ce·tte dernier·ère vient d’un milieu moins favorisé que celui d’Andrea, rythme le séjour chinois et le clôt également. En effet, les tribulations de Jenny sur le marché du travail incarnent la position extrême d’une précarisation à comprendre comme un continuum – qui existerait d’ailleurs si les deux avaient choisi la destinée suivante également, en attestent les récentes coupes budgétaires dans la recherche et l’immigration : « donner des cours de français en Suisse : Deniz au Service de l’inclusion et Andrea à l’Université » (66). Mais si la Chine ou la Suisse, malgré leurs différences apparentes, semblent finalement se fondre – car pas d’ailleurs dans le monde néolibéral ici portraituré, « en Chine et en Suisse, donc. Peu importe » (195) – les diverses possibilités d’une existence s’étirent entre deux continents, deux désirs, deux ambitions, et un enfant entre deux : « plus le couple s’éloigne et plus l’enfant les rapproche. » (p. 123) Autrement dit, le monde est absurde, quel que soit le lieu. Alors comment vivre, faire famille, avancer ?Il importe maintenant de préciser : l’écriture inclusive utilisée dans ce compte-rendu n’est pas une coquetterie de critique queer, mais bien la transcription de ce qui fait l’autre originalité du roman d’Ed Wige, et la force de la collection « Grattaculs » de Paulette dont j’ai déjà parlé à cet endroit, qui laisse à ses écrivain·es la liberté d’une « langue vivante, plurielle et inclusive » (deuxième de couverture) en plus de mettre à l’honneur des récits queer. Dans Travelling, la voix narrative refuse habilement d’assigner un genre aux personnages principaux, rejetant le pouvoir médical qu’elle prend d’habitude par autorité, en décrivant des parties du corps qui n’évoquent pas la binarité : “Qu’aime exactement Deniz chez Andra ? Les nuances azur de ses yeux ? Ou les mèches en sueur qui les entravent quand Andrea trime son corps ? L’imperfection de sa peau ? Sa voix éraillée et gémissante à la fois ? Est-ce que la dextérité de ses mains qui déclenche la folie?” (15) Sans faire recours à un seul moment au point médian, elle dépeint cette histoire d’amour dans une narration qu’on pourrait appeler non-binaire, au sens trans* du terme : la non-binarité désigne des personnes dont l’identité de genre se situe en dehors du modèle binaire homme ou femme. D’où l’importance du travelling : non-binariser, c’est refuser l’exit et stop, c’est refuser l’alternative simple, le ou (disjonctif) et préférer le et (conjonctif, accumulatif), c’est partir du script attendu pour dévier, encore et encore. Au lieu de prendre leur mal en patience et « sillonner [la Chine] immense dans tous les sens », un « coup du sort » : « leur couple allait avoir un bébé. » (99) Là aussi, la question de qui porte l’enfant est maintenue dans le flou, au profit de ce qui est plus intéressant : l’effet de cette prochaine naissance sur les parents. Transformations, bifurcations identitaires, incarnées par l’initiation au drag à laquelle participe Deniz pour passer le temps à Shanghai : « Car dans ce miroir, chaque semaine, Deniz devient d’autres personnes, que ce soit Miss Bella Stanbul, Coco Damn – comme ce mercredi soir – Dany Atta Bello. Et ces personnes, à présent, sont autant de versions de Deniz. » (155) Andrea, en face, aliéné·e par un travail dans lequel iel se sent plus connecté·e au poisson-dragon de l’aquarium du hall central (156) qu’à ses collègues, s’effondre en sanglotant car « la production sera délocalisée. Tout le monde sera viré. » (176) Précarités matérielles, précarité identitaire – cette dernière n’ayant pas à être idéalisée, puisque les personnes queer et plus particulièrement trans* souffrent plus de la précarité financière que les autres populations –, le récit d’Ed Wige expose les ramifications d’existences qui refusent de suivre les prescriptions sociales et inventent autre chose, sans pour autant oblitérer les contraintes matérielles capitalistes. Si comme Andrea ou Deniz vous « navigu[ez] à vue dans le flou artistique de la vie » (189) je vous conseille de faire, comme Jenny, un « choix net » (189) : lire ce livre.
Val Bovey
Image de couverture : https://www.paulette-editrice.ch/ouvrages/travelling/