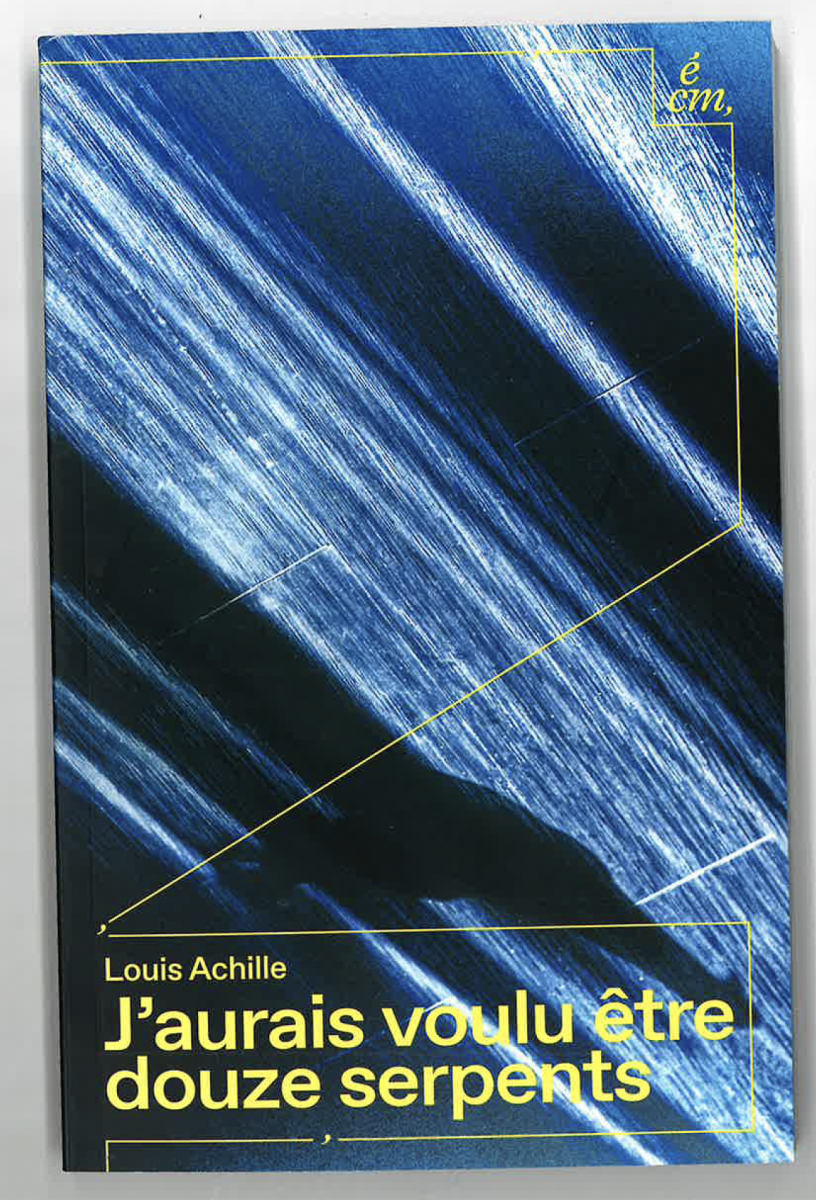Compte rendu de Louis Achille, J’aurais voulu être douze serpents, Genève, Cousu mouche, 2025, 171 p.
J’aurais voulu être douze serpents (2025) raconte la quête d’identité personnelle et le cheminement de Louis Achille, auteur et personnage principal du roman à la première personne. De l’enfance à l’âge mûr, en passant par les fugues et les cuites de l’adolescent, le texte restitue dans une langue neuve et singulière les étapes et les épreuves d’un parcours de vie ancré dans une famille disjointe qui, elle-même, prend ses racines dans un tissu intergénérationnel difficile, mais il met aussi en scène une série d’expériences typiques de la jeunesse des années 1990, 2000 et 2010, brossant ainsi le portrait d’une génération. L’écriture se saisit de cette mémoire individuelle, familiale et collective et vient la mettre en travail de l’intérieur, recousant les fils qui peuvent l’être tout en faisant la paix avec les déchirures, les trous, l’absence. Au cœur du récit, il y a bien sûr l’identité individuelle et le trajet du je, mais il y a aussi une dialectique de la destruction (de soi et des autres) et de la création (de soi et du lien avec les autres), du chaos et du désordre.
Avant de développer ces différents aspects, il convient de s’interroger sur le titre de l’œuvre. On entend d’abord l’aspiration d’un sujet (j’aurais voulu), mais d’emblée son désir d’absolu, au conditionnel passé, est donné à lire comme dépassé, tout à la fois révolu, démesuré et impossible, celui d’« être douze serpents », où transparaissent l’illimitation et la fragmentation du soi, la démultiplication des potentialités et l’accroissement de la puissance créatrice (douze), mais aussi la fluidité d’un mouvement vital et le contact direct avec la terre et l’origine, la reptation sensuelle et la concrétude de la matière, des sensations (serpents). Le symbole apparaît ainsi comme une clé d’interprétation d’un rapport esthétique à l’identité, à l’écriture, au monde : « La matière est une coulée noire, dans mes doigts, elle glisse, on dirait un serpent qui file dans un buisson » (139). En d’autres termes, l’aspiration frustrée (j’aurais voulu) exprime paradoxalement le désir et le deuil de la plénitude ; l’envie de vivre dans un monde plein, saturé de sensations riches, à l’image de celui que l’écriture invente et le renoncement à l’absolu, à la fusion, comme en témoigne notamment la transformation subjective liée à l’expérience amoureuse : « Plus de pourquoi. La question c’est comment, comment aménager des espaces, comment transformer ces sentiments en forces pour l’autre, comment les vivre ensemble » (164).
Pris entre deux lignées familiales, l’une populaire (côté maternel), l’autre diplômée de l’enseignement supérieur (côté paternel), le narrateur retrace les origines d’une famille de la petite classe moyenne, la séparation entre les parents, les problèmes personnels du père. Il donne ainsi à sentir, à chaque étape du récit, la manière dont l’histoire sociale et psychique de la famille pèse sur ses épaules : Louis est conditionné, contraint, déterminé par le poids du passé familial, mais Louis ne cesse aussi de contester l’héritage complexe auquel il est assujetti, de le travailler de l’intérieur, de s’y confronter et de s’y débattre. Ainsi, la tendance du protagoniste à fuir devant ses problèmes, à choisir l’alcool, l’errance, l’aventure au bout de la nuit, plutôt que d’affronter le réel, est donné à voir comme une défense à l’égard des figures paternelles (le père ; le beau-père, Carmine) qui, l’un et l’autre, incarnent à la fois l’ordre établi et la rébellion, la marginalité, le rejet des normes. Sans prétendre proposer une analyse approfondie de ces enjeux, il m’apparaît que le roman met en scène de manière précise le système familial et la manière dont il est vécu par le je-narré (l’enfant raconté), donnant ainsi à voir la manière dont le sujet forme ses plis, la façon dont ses dispositions se structurent en réponse à l’environnement familial, scolaire et social.
Ce point est d’une importance centrale puisque le rapport de défiance à l’égard de la norme façonne en profondeur la trajectoire du je : rejet des pratiques sociales et des valeurs associées à la classe bourgeoise ; rejet de l’excellence scolaire ; rejet de la propreté et du rangement – « Je suis contre l’ordre des choses donc le rangement est l’ennemi numéro un […] Ma révolte se fait dans le chaos que je m’impose » (83) ; rejet de « la langue-prison académique » (85) ; rejet du travail perçu comme un temps volé, etc. À l’inverse, le protagoniste se met en quête d’expériences hors-cadre : désir presque mystique d’un rapport absolu et immédiat à soi, l’autre et le monde ; tendance à l’autodestruction, qui apparaît comme une sorte d’assaut mené à l’intérieur de soi contre l’ordre, la structuration, et ce, au détriment de la sensibilité, comme en témoigne le bel épisode où la posture et la poésie de Charles Bukowski (fortement marquées par des dynamiques d’autodestruction) deviennent une interface thérapeutique entre le protagoniste et son enseignante d’anglais ; recherche, durant la longue jeunesse, du « point de non-retour », jouissance de « marcher sur le précipice de la folie » (67), comme s’il s’agissait là encore d’attaquer, au cœur de la psyché propre, la rationalité, elle-même assimilée, en dernière instance, au carcan répressif de l’ordre établi, entravant la vitalité et l’expressivité du corps, l’intensité et l’authenticité du lien, la possibilité d’une communion réelle avec les autres.
Mais au terme du récit, le sujet confère au refus de l’ordre une valence nouvelle, simultanément affective, politique et émancipatrice. De la négation, il passe à l’affirmation de nouveautés en adéquation avec la vie, se reconnaissant par exemple dans le désir des zadistes de créer de « nouvelles formes de cohabitation et d’organisation sociale » (149). Dans l’ordre sociopolitique comme dans l’ordre esthétique (l’écriture) et existentiel (la vie quotidienne), l’invention apparaît comme la solution permettant de conserver le rejet de l’ordre existant – « vous les camions, les patrons, les tanks » (169) – tout en créant des régimes de normativité et de structuration à même de renouveler les rapports sociaux. En résumé, il s’agit d’en finir avec l’autodestruction de l’adolescence (bitures, errances, stratégies esthétiques et existentielles d’“auto-clochardisation”) pour accéder au registre de l’affirmation (amoureuse, politique, esthétique), ce qui transite notamment par l’épanouissement dans diverses pratiques ordinaires (le vélo, le tatouage, les joies du corps, le style de vie) qui, à leur manière, permettent au sujet d’inscrire sa singularité dans l’ordre du monde.
Dans ce passage des formes de négation de soi aux formes d’affirmation de soi, l’écriture occupe une place fondamentale. Un extrait exprime l’un des traits dominants de l’esthétique du texte qu’on pourrait qualifier de sensualisme sale. Après avoir été paralysé par la monumentalité des œuvres du canon littéraire, le narrateur déclare, avec une résolution manifestaire : « Fini la littérature blanche : je veux fabriquer une littérature dans laquelle on se mouche, la tremper dans mon café, les mains pleines de cambouis » (86). Les taches, fluides, déchets et autres réalités socialement dévalorisées sont associées au réel, à la vie du corps qui (re-)prend ses droits et refuse de se plier aux normes sociales et linguistiques. Omniprésence de la matérialité, présence à l’immédiateté du vécu et sensations en excès caractérisent l’écriture du monde : « L’aube arrive. Elle est blanche et rose presque sirupeuse elle nous emballe. On se sert un verre de rosé, c’est l’aube qui coule dans nos gorges, on regarde la cuisine maculée de rouge, la farine collée, le chocolat coule. L’évier déborde de vaisselle mais sur la table nos créations paradent. Ça croustille, ça sent le romarin » (75). Très écrit, le roman intègre avec justesse la prosodie de la langue parlée, recourt au procédé du discours direct libre pour intégrer de manière dynamique les dialogues à la texture du récit, incorpore de manière convaincante des unités lexicales familières, courantes dans le langage ordinaire mais peu utilisées en littérature. Sensualiste, rythmée et poétique, la proposition stylistique de Louis Achille fait ainsi entendre une singularité expressive.
Outre le fait qu’il s’agit d’un bon livre, je recommanderais enfin ce roman parce qu’il parvient selon moi à saisir une époque avec justesse, à en extraire les “petits faits vrais”, les phénomènes de masse, la tonalité. À travers l’histoire du personnage principal, Louis Achille décrit une trajectoire de vie singulière, mais il brosse aussi le portrait transindividuel de la « jeunesse désenchantée » des pays occidentaux actuels. Le texte donne à sentir avec force la désorientation et le désespoir noyés, les aspirations au changement, le rejet d’un monde chaque jour plus injuste et violent, notamment symbolisé par la norme hétéro-patriarcale, la “toxicité” navrante du père et, bien sûr, l’État, décidé à réprimer toute forme d’expérimentation politique et de nouveauté égalitaire.
Vivien Poltier